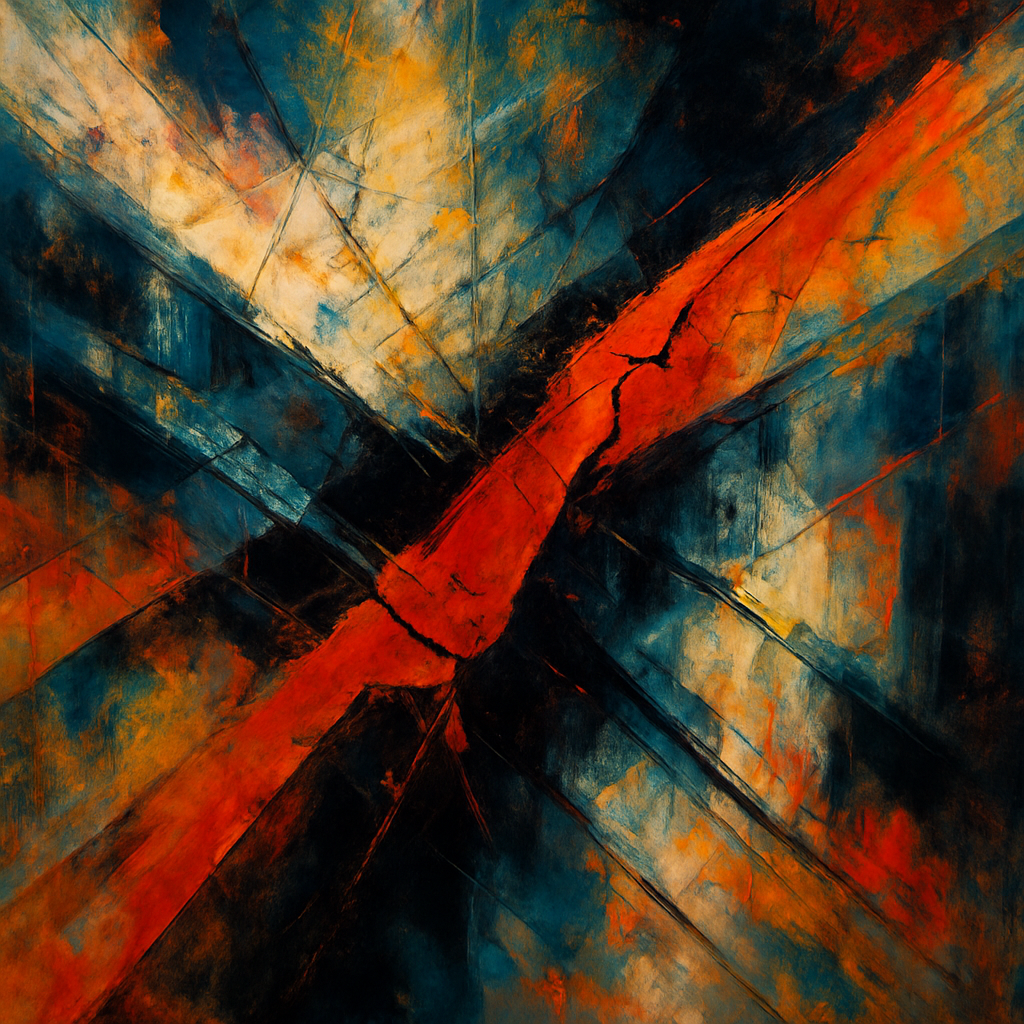
Pourquoi l’Intelligence Artificielle marque-t-elle la fin du capitalisme ? · Partie III : La fin comme rupture
Aucun système humain n’a pris fin dans le silence. Ni les empires, ni les religions hégémoniques, ni les modèles économiques qui semblaient inébranlables ne se sont dissous de manière graduelle et ordonnée. Les systèmes humains ne s’achèvent pas : ils se brisent. Ils se maintiennent tant qu’ils parviennent à convaincre la majorité que leur existence est naturelle, nécessaire ou du moins tolérable ; mais lorsque ce soutien s’estompe, lorsque la légitimité s’évapore, la fin ne prend pas la forme d’une extinction progressive, mais d’une fracture. Parfois, cette rupture est physique, sous la forme de guerre ou de révolution ; parfois, elle est institutionnelle, symbolique ou psychologique, un effondrement moins visible mais tout aussi dévastateur, où ce qui semblait stable s’écroule soudainement.
L’histoire est jonchée de ces éclatements. L’Empire romain ne s’est pas retiré de la scène pour céder la place à une nouvelle ère : il s’est effondré, miné par des guerres internes, des pénuries, la corruption et une perte irréversible de confiance en la promesse impériale. Les monarchies absolues européennes n’ont pas cédé leur place à la démocratie par un geste éthique, mais parce que l’Ancien Régime ne proposait plus aucune justification crédible pour subsister. La Réforme protestante n’a pas été une transition doctrinale ordonnée, mais un schisme survenu lorsque l’Église n’a plus pu maintenir la concordance entre son discours spirituel et sa pratique institutionnelle. Même l’URSS, l’un des projets politiques les plus rigoureusement organisés du XXe siècle, n’a pas disparu par défaite militaire : elle s’est fracturée lorsque sa légitimité idéologique et productive s’est épuisée et que la population a cessé de croire au récit qui donnait sens à des décennies de sacrifice.
La constante historique est claire. Les sociétés peuvent tolérer durant des générations des conditions qui, rétrospectivement, apparaissent insupportables : la faim, l’inégalité extrême, la répression, l’exploitation systématique. Mais aucune structure ne survit lorsque la majorité retire son consentement, même si ce consentement est passif, résigné ou silencieux. Car tout système humain, même concentré entre les mains d’une élite — rois, prêtres, bureaucrates, technocrates ou magnats — dépend toujours, d’une manière ou d’une autre, d’une large légitimation sociale. Cette légitimation peut prendre diverses formes : la peur, la foi, la prospérité, l’habitude, la résignation. Mais lorsqu’elle disparaît, même les systèmes qui semblaient éternels s’effondrent. L’aristocratie française a vécu des siècles convaincue de son droit naturel à exister jusqu’à ce que la combinaison de la faim, de la crise fiscale et de l’humiliation quotidienne rende impossible le maintien de la fiction. Ce fut également le cas des empires coloniaux après la Seconde Guerre mondiale ou des dictatures latino-américaines qui se sont maintenues tant que la population en acceptait, par désespoir ou par peur, l’autorité. Lorsqu’un système perd la capacité de persuader, d’intimider ou d’inspirer la majorité, il ne se réforme pas : il se brise.
Pour comprendre pourquoi le capitalisme contemporain s’approche de ce type de rupture, il est nécessaire de remonter à la Guerre froide, son moment de plus grande légitimation historique. Durant cette période, le capitalisme a dû montrer son meilleur visage, non par altruisme mais par rivalité géopolitique. Face au communisme soviétique — capable d’articuler un récit alternatif et une promesse redistributive —, le capitalisme a déployé des politiques qui semblent aujourd’hui exceptionnelles : systèmes étendus de protection sociale, droits solides des travailleurs, syndicats dotés d’une réelle capacité de négociation, accès généralisé à l’éducation, à la santé et au logement. Entre les années 1950 et 1970, dans une grande partie de l’Occident, les niveaux de redistribution ont atteint des records historiques : des taux marginaux d’imposition sur les grandes fortunes supérieurs à 70 %, une croissance salariale en adéquation avec l’augmentation de la productivité et une réduction constante des inégalités. Ce ne fut pas une transformation morale du système, mais une parenthèse fonctionnelle : une suspension temporaire de sa logique pour maintenir sa légitimité.
Cette parenthèse a pris fin dès que l’antagoniste a disparu. La chute du Mur de Berlin n’a pas seulement marqué la fin du socialisme réel ; elle a libéré le capitalisme de toute obligation de retenue. L’accumulation, la déréglementation et la maximisation du profit ont repris le devant de la scène. Le néolibéralisme n’a pas été une déviation idéologique, mais le retour du capitalisme à sa trajectoire originelle.
Dans ce nouveau contexte, le système a démontré un point décisif pour comprendre sa crise actuelle : il peut fonctionner tout en excluant une large partie de l’humanité. Durant quarante ans, le capitalisme n’a pas mis de côté les 50 % les plus pauvres de la planète ; il les a exploités dans des conditions de précarité extrême, de salaires de subsistance et de vies réduites à la simple survie. Il n’a assuré ni niveau de vie minimum, ni droits fondamentaux stables, ni sécurité matérielle. Il a utilisé cette moitié de la population quand il en avait besoin — dans les usines, les champs, la construction ou les services — et les a relégués dès lors qu’ils n’étaient plus rentables. Et pourtant, le système n’a pas sombré : il s’est étendu, sophistiqué, mondialisé et a concentré les richesses comme jamais auparavant.
Il a pu le faire parce qu’il conservait encore sa base de légitimation. Le capitalisme a continué de fonctionner parce qu’il maintenait dans le pacte environ la moitié restante : une élite restreinte et une large classe moyenne mondiale. Non parce que cette classe moyenne serait moralement plus importante, mais parce qu’elle était fonctionnelle au système.
Ce fragile équilibre de la classe moyenne mondiale — soit environ 40 % de la population — commence à se fissurer lorsque l’automatisation cognitive, rendue possible par le développement de l’IA, menace justement le groupe qui continuait à légitimer le système. Durant des décennies, le capitalisme s’est appuyé sur le pacte du travail : emploi stable, carrière ascendante, effort récompensé, identité construite autour du mérite. Ce pacte constituait la colonne vertébrale de la classe moyenne. Mais quand l’IA rend obsolètes non seulement les emplois manuels, mais aussi ceux administratifs, techniques, créatifs et professionnels, ce contrat symbolique se désintègre. Continuer dans cette direction ne signifie plus exclure la moitié de la population, mais pousser le système vers un scénario où jusqu’à 90 % de l’humanité risque d’être structurellement reléguée.
Pendant quarante ans, le capitalisme a volontairement omis la moitié la plus pauvre de la population sans garantir ne serait-ce que des conditions de vie minimales. Parallèlement, il a étourdi la classe moyenne mondiale par un bipartisme qui, sous couvert de promesses récurrentes d’ascension sociale et de stabilité, a systématiquement débouché sur une pression fiscale accrue sur ses revenus, un endettement à vie et des politiques redistributives qui n’ont jamais touché les grandes fortunes. Le mérite a été utilisé comme outil de domestication et l’endettement comme mode de contrôle. Donner le minimum pour extraire le maximum fut la formule permettant au système de perdurer en excluant un humain sur deux. La question n’est plus de savoir s’il peut continuer à le faire, mais pourquoi il croit qu’il peut le faire.
Et il a des raisons d’y croire.
La première est historique et anthropologique. Les élites n’ont jamais su s’arrêter. Rois convaincus de leur droit divin, empereurs obsédés par l’éternité, aristocrates accrochés à des privilèges irrationnels, magnats pour qui la richesse signifie prédestination. L’élite capitaliste mondiale n’est pas différente. Elle agit comme si sa position était naturelle, permanente et incontestable, même lorsque le système dont elle dépend montre des signes évidents d’épuisement.
La deuxième raison est structurelle. La financiarisation a rompu le lien entre population et richesse. L’économie ne dépend plus directement du travail ni de la consommation de la majorité. La richesse se multiplie dans des circuits autonomes — dette, dérivés, spéculation et fonds d’investissement — qui permettent au capital de croître en marge de la vie matérielle de la population. Cette fiction d’auto-suffisance repose sur une règle fondamentale : le jeu est truqué dès le départ, car 1 % de la population contrôle près de la moitié des actifs financiers. La maison gagne toujours.
La troisième raison est mathématique. En dehors de l’élite, il ne reste qu’environ 25 % de la richesse mondiale à absorber. Logement, éducation, santé, épargne et retraites deviennent les derniers territoires d’extraction. À l’intérieur même du système, il reste peu à capter, mais assez pour continuer d’avancer, fort de l’expérience de quatre décennies durant lesquelles il a pu laisser de côté la moitié de l’humanité sans conséquences immédiates.
Ces dynamiques aboutissent à une erreur fatale : le capitalisme estime pouvoir continuer sans la majorité car il a appris à s’en passer. Mais cette illusion se heurte à la mécanique historique de tous les systèmes humains. Aucune structure ne survit lorsque la distance entre l’élite et la population devient illimitée, quand la légitimité s’évapore et que la vie quotidienne se transforme en une expérience continue de précarité.
Le capitalisme contemporain introduit cependant une nouveauté inquiétante. Jamais un système n’avait disposé d’un appareil aussi sophistiqué de gestion du mal-être, de dissuasion, de surveillance, de divertissement et de production symbolique. L’érosion de légitimité, qui débouchait jadis sur des ruptures visibles, peut aujourd’hui se diluer dans des sociétés atomisées, dépolitisées, où l’épuisement ne conduit pas toujours à l’action collective. Par un appareil de communication mondial sans précédent, concentré entre très peu d’acteurs, avec un accès illimité à la diffusion idéologique et au divertissement immédiat, le système peut se prolonger en gérant la frustration au lieu de la résoudre.
Le monde dans lequel nous vivons ne ressemble pas à la dystopie d’Orwell dans 1984. Il ressemble de plus en plus à celle de Huxley dans Le Meilleur des mondes : segmentation sociale figée, endoctrinement passif déguisé en culture populaire, anesthésie pharmacologique, divertissement infini comme substitut au sens. Il n’est pas nécessaire de réprimer massivement lorsqu’on peut distraire en permanence. Il n’est pas nécessaire de convaincre quand il suffit de divertir.
Mais même ces mutations ont une limite. Aucun système ne peut se maintenir indéfiniment lorsque l’expérience matérielle de la majorité devient une succession ininterrompue de pertes, de précarité et d’épuisement. La gestion numérique du mécontentement peut retarder la rupture, mais non l’abolir. Elle peut endormir un symptôme, mais pas guérir la maladie. Un ordre qui confie sa survie à la dissuasion, la surveillance et la précarisation peut prolonger son agonie, mais non changer son destin.
Formés à l’immédiateté, à la consommation comme substitut au désir et au divertissement comme anesthésie, nous ne concevons plus que deux scénarios : l’effondrement immédiat ou son impossibilité. S’il n’a pas lieu maintenant, nous considérons qu’il n’aura jamais lieu. Mais l’histoire ne fonctionne pas ainsi. La plupart des systèmes ne s’effondrent pas lorsqu’on s’y attend ; l’histoire humaine s’est révélée explicable, mais non prévisible.
Là réside le paradoxe final. Le capitalisme automatisé pourrait ne pas se briser brusquement. Il pourrait se dégrader lentement, muter, persister comme une structure diffuse et vide. Mais s’il continue à supposer que la précarisation totale de la vie pour la majorité est gérable avec plus de dissuasion, plus de technologie et plus de fragmentation sociale, il finira par rencontrer la même limite historique que tous les systèmes ayant poussé trop loin leur logique interne. Il peut retarder la rupture. Il peut la masquer. Il peut l’anesthésier. Mais il ne peut l’éviter s’il sacrifie la base humaine qui le soutient.